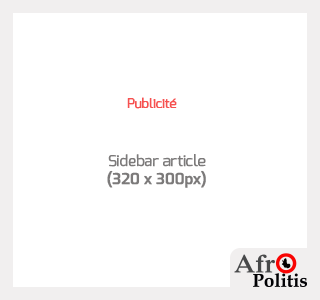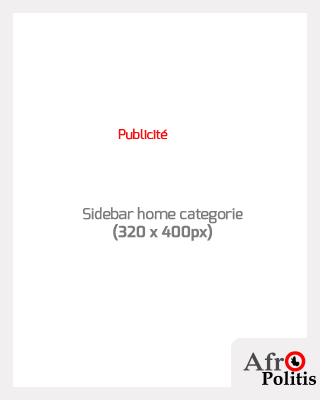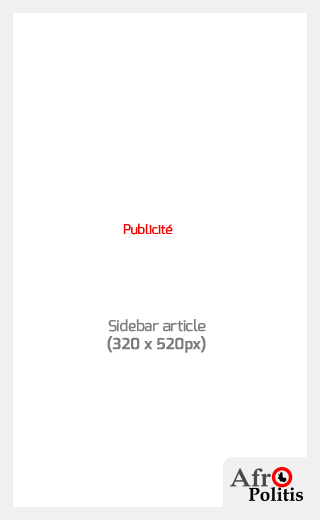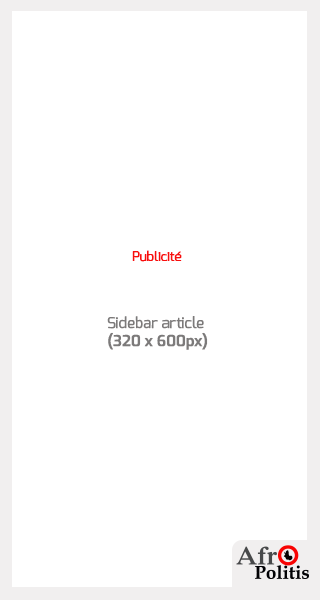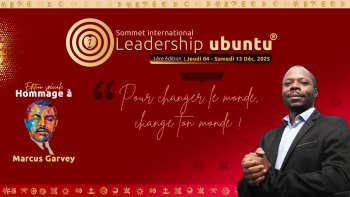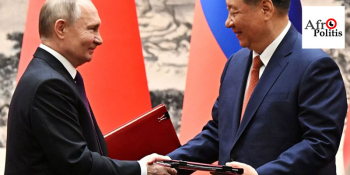La Russie n’aura plus de troupes au sol en Syrie. Cette annonce du retrait partiel militaire russe de Syrie a surpris autant que l'irruption de la Russie sur le champ de bataille syrien au mois de septembre dernier. Au terme d'une campagne aérienne de 167 jours, alors que le régime de cessation des hostilités en vigueur depuis le 27 février semble tenir, et que le processus de résolution de la crise s'est réouvert à Genève, comment comprendre cette décision inattendue prise par le président russe ?
La première question porte sur le moment choisi par Vladimir Poutine pour annoncer ce retrait partiel. Au-delà de la concordance de date avec le calendrier de la tragédie syrienne qui a débuté le 15 mars 2011, l'annonce du désengagement signifie que le Kremlin estime avoir atteint les objectifs qui sous-tendaient son intervention et avoir maximisé ses gains au plan politique. À l'échelle internationale, les presque 6 mois de campagne aérienne russe ont permis l'instauration d'un duopole américano-russe pour la résolution du conflit syrien, relativisant – sans pour autant le briser – l'isolement dans lequel la communauté euro-atlantique a cherché à confiner la Russie suite à la crise ukrainienne. Le Kremlin s'est retrouvé à opérer sur le front diplomatique en tandem avec Washington, et leur action commune semble suffisamment puissante pour produire des résultats tangibles en matière sécuritaire (armes chimiques syriennes, 2013) et diplomatique (format de Vienne, puis discussions à Genève), y compris sur un dossier aussi compliqué que celui de la crise syrienne.
L'engagement russe visait également à prévenir un nouveau changement de régime, après ceux intervenus en Irak et en Libye, par l'entremise d'acteurs locaux et régionaux que Moscou estime être soutenus par l'Occident. À l'échelle du Moyen-Orient, son intervention a propulsé la Russie au rang de puissance régionale incontournable pour la résolution de la crise syrienne dans la mesure où Moscou a maintenu le dialogue avec le plus grand nombre d'acteurs : les monarchies du Golfe, l'Iran, le Hezbollah, Israël, des États arabes sunnites tels que l'Égypte et la Jordanie, les Kurdes, et, bien sûr, Damas. La détermination de l'engagement russe en Syrie a nettement contrasté avec les atermoiements des États-Unis, par ailleurs prompts à abandonner un allié de longue date, comme le président égyptien Hosni Moubarak, lorsque ce dernier fit face à un soulèvement populaire début 2011. Vue du Golfe notamment, la crédibilité de la Russie comme partenaire n'est plus à démontrer. Au plan local, la campagne aérienne russe a inversé dès la fin de l'année 2015 le rapport de force sur le champ de bataille en le rendant favorable au régime syrien qui aborde ainsi le nouveau tour des négociations à Genève dans une posture suffisamment solide. À ce titre, il convient de remarquer que, dès le mois de décembre 2015, Vladimir Poutine insistait en conférence de presse sur le fait que les forces russes n'avaient pas vocation à rester en permanence en Syrie. Selon le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, l'action de l'aviation russe a permis au régime de reprendre le contrôle de 10 000 km² de territoire, soit l'équivalent d'un peu plus de 5 % de la superficie du pays. Quelque limités que puissent paraître ces gains, ils obèrent tout renversement du régime. Toujours d'après le ministère de la Défense, les frappes russes auraient en outre permis de neutraliser près de 2 000 jihadistes venant de Russie. Enfin, l'armée syrienne est par ailleurs à peine capable de tenir le terrain repris à ses adversaires, ce qui revient à dire qu'elle a atteint l'extension maximale de son périmètre d'action, et que poursuivre l'offensive, dans l'optique d'une improbable reconquête du territoire syrien, risque de compromettre les gains chèrement acquis.
Loin de disparaître, l'empreinte militaire de la Russie en Syrie va évoluer. La réduction de la voilure des forces russes devrait se traduire par le retrait de la majorité des quelque 6 000 hommes dont Moscou disposerait à ce jour en Syrie, ainsi que de la soixantaine d'appareils déployés sur la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié. La Russie conserve les installations navales dont elle dispose à Tartous, ainsi que la base aérienne où pourrait subsister un détachement aérien fort d'une dizaine d'appareils et où pourrait être maintenu un contingent de 1 000 à 1 500 hommes. Comme indiqué par Vladimir Poutine lors de sa réunion avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, les sites russes en Syrie devront faire l'objet d'une protection complète, ce qui incite à penser qu'en dehors du maintien des systèmes antiaériens S-400, la batterie de missiles antinavires Bastion devrait aussi rester opérationnelle, de même que les systèmes de défense antiaériens Pantsir-S1, Buk-M3 et Tor-M2. Le maintien de ces systèmes permet à la Russie de conserver sa « bulle » d'interdiction au Levant et lui donne une carte à jouer pour de futures négociations. Au demeurant, si la situation le nécessitait, Tartous et Hmeimim restent deux points d'entrée par lesquels Moscou pourrait redéployer une force expéditionnaire. Les capacités russes qui restent en Syrie poursuivront les frappes contre des cibles désignées par Moscou comme terroristes, au premier rang desquelles se trouvent le groupe al-Nosra (el-Qaëda) et l'État islamique (EI).
L'annonce du retrait partiel des forces russes de Syrie signifie par ailleurs que le processus diplomatique à Genève est effectivement lancé. Bien que présenté comme étant le fruit d'un accord concerté avec Damas, il ne faut pas écarter la possibilité que le désengagement de Moscou constitue une manœuvre visant à infléchir la position de Bachar el-Assad lors des négociations de paix. Les déclarations du président syrien sur ses ambitions de reconquête du pays, l'annonce de la tenue d'élections législatives au mois d'avril prochain, ou encore la « ligne rouge » évoquée par la délégation syrienne – faisant allusion à l'évocation du sort de Bachar el-Assad lors des négociations de paix – à la veille de la reprise des discussions à Genève ont pu convaincre le Kremlin qu'il était temps d'atténuer son soutien à Damas. L'allègement du dispositif iranien en Syrie – Téhéran aurait annoncé concomitamment au désengagement russe le départ de près de 2 500 de ses 6 000 hommes déployés sur le terrain – tendrait également à faire peser plus fortement sur les épaules du président syrien et du Hezbollah le fardeau militaire, rendant ainsi Damas plus réceptif aux négociations. La Russie est par ailleurs parvenue à imposer son agenda en contraignant les groupes rebelles soutenus par les Occidentaux à faire un choix : continuer le combat, notamment aux côtés d'al-Nosra, et donc s'exposer à des bombardements désormais acceptés par les États-Unis, ou se battre contre el-Qaëda et l'État islamique, et prétendre à un rôle politique dans le futur de la Syrie.
Une des principales conséquences du retrait russe est qu'il hypothèque l'escalade militaire et l'enlisement sur le champ de bataille syrien. En cas d'échec des négociations, la Russie n'aurait eu en effet guère d'autres possibilités que de poursuivre avec l'option militaire en musclant son dispositif. Or, en réduisant graduellement son empreinte militaire dès aujourd'hui, Moscou se réserve la possibilité de pouvoir revenir demain, sans que cela ne soit interprété comme un enlisement, voire une défaite. En outre, en décidant de se retirer au moment où le régime de cessation des hostilités semble fonctionner et où l'intensité des combats paraît diminuer, la Russie souhaite non seulement donner l'impression qu'elle reste maîtresse du tempo, mais elle cherche aussi à renvoyer une image victorieuse de sa campagne. Le tableau aurait été sensiblement différent si les appareils russes avaient entamé un retrait alors que les combats faisaient rage, ce qui aurait véhiculé une image de défaite. Selon certaines sources, des consultations avec Washington auraient précédé la décision de Moscou, et les États-Unis auraient accepté de donner des garanties au clan de Bachar el-Assad de cesser leur soutien aux forces rebelles dites fréquentables et de promouvoir la fédéralisation de la Syrie lors des négociations de paix à Genève. Le schéma fédéral permettrait de préserver l'intégrité territoriale du pays, de dédommager les Kurdes syriens avec qui Russes et Américains coopèrent activement, et de cristalliser l'influence russe dans la région côtière syrienne. Au demeurant, le régime comme les rebelles restent à ce jour fortement opposés à cette solution.
Si la Russie a réalisé une démonstration de force en Syrie, elle n'est cependant pas parvenue à briser l'isolement dont elle fait l'objet de la part de la communauté euro-atlantique depuis la crise ukrainienne, et les appels de Vladimir Poutine à la formation d'une grande coalition contre le terrorisme ne se sont pas matérialisés, même après les attentats de Paris. En outre, la campagne syrienne a compromis les bonnes relations que Moscou entretenait avec Ankara, et l'intensification des relations russo-kurdes ne devrait guère infléchir cette tendance à moyen terme. Le coût de l'opération militaire en Syrie a aussi pu être évoqué comme une limite de l'engagement russe et une des motivations sous-tendant le retrait décidé par le président Poutine. Selon les sources, le coût quotidien des opérations militaires russes en Syrie s'élèverait à 3 millions de dollars, ce qui représenterait un total de 500 millions de dollars pour l'ensemble de la campagne. À ce chiffre s'ajoutent d'autres frais générés par exemple par les tirs de missiles de croisière Kalibr. Le coût unitaire de ces missiles est évalué à 750 000 dollars, ce qui donne une note de 36 millions de dollars pour les 48 missiles tirés depuis la mer Caspienne et la Méditerranée. Sa campagne syrienne aura donc coûté au Kremlin un budget nettement inférieur au milliard de dollars, un montant qui pourrait bien être couvert par la signature de futurs contrats d'exportation d'armements stimulés par les démonstrations de matériels réalisées par l'armée russe sur le « polygone syrien ». Enfin, si l'État islamique a été affaibli par les quelques bombardements russes qui l'ont ciblé, il n'en demeure pas moins que Daech contrôle toujours la majeure partie de la Syrie orientale. Rétrospectivement, s'engager en Syrie en annonçant combattre Daech était un objectif très ambitieux promis au mieux à une vive désillusion.
La campagne aérienne russe a démontré que la Russie était capable de modifier l'équilibre des forces sur un champ de bataille situé en dehors de l'espace post soviétique, à travers le déploiement temporaire d'une force expéditionnaire de taille modeste, pour un coût financier tout aussi modeste, avec des pertes minimales : 3 hommes tués, 1 hélicoptère détruit au sol, et 1 avion abattu par un pays membre de l'Otan. À travers ce désengagement graduel, la Russie démontre qu'elle est prête à accorder son soutien à un partenaire, mais pas à n'importe quel prix. Le Kremlin semble avoir plus que jamais fait sienne la pensée de Machiavel qui écrivait dans Le Prince que l'« on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut ». La décision du président russe s'inscrit également dans une approche clausewitzienne de la guerre : après avoir fait la démonstration de sa capacité à manier le hard power pour atteindre des objectifs politiques, le Kremlin démontre sa capacité à mettre un terme à son usage pour donner sa chance à la diplomatie.
Auteur: IGOR DELANOË
Directeur adjoint de l'Observatoire
(Centre d'analyse de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe)